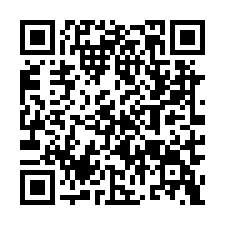Les documents dont nous disposons aux archives du département et de la commune, joints aux souvenirs des plus anciens de nos compatriotes permettent de connaître assez bien la vie de notre village en 1910.
L’étude sera divisée en deux parties : la population, la vie quotidienne.
LA POPULATION
Au recensement de mars 1911 notre village accuse une population de 616 habitants, 459 dans le village, 157 dans les fermes et hameaux. Les noms sont pour la plupart ceux d’aujourd’hui ; les habitants actuels sont, dans leur majorité, les enfants ou petits-enfants de ceux de 1910.
Et maintenant, comme le fait quotidiennement le facteur, parcourons le village, de porte en porte et de maison en maison.
Les 459 habitants du village proprement dit sont répartis en 124 maisons avec 146 ménages ; parmi ces 459 habitants 446 sont de nationalité française, 13 étrangère (italienne). En 1910 le village commence au pont sur la Méouge. Au-delà, à gauche, sur la route du Nord, l’Essaillon n’a que trois remises ; à droite de la route sont le cimetière (l’ancien cimetière : le nouveau étant utilisé depuis une quinzaine d’années), le poids public et l’Eglise.
Les 124 maisons du village sont, dans le recensement, réparties en 4 groupes :
- la Grande Rue, la plus importante : 69 maisons sur 124,
- la Place et la Basse Rue,
- la Rosière,
- la Bourgade.
La Grande Rue
...concentre plus de la moitié de la population, quelques agriculteurs mais surtout des artisans et commerçants. Remontons la sur la droite en partant du Pont.
Nous trouvons : un retraité de 77 ans Jean Baptiste Guérin ; le cafetier Henri Jullien ; Baptistin Chandre entrepositaire de journaux et sa femme ; Albert Ville, cordonnier, sa femme, ses deux enfants ; Elie Plaindoux, épicier, sa femme, son fils et deux domestiques ; un cultivateur Appolinaire Dethès et sa mère ; un tailleur d’habits Auguste Samuel ; puis c’est la maison du bureau de bienfaisance occupée par l’école de garçons avec l’instituteur Henri Moncquet ; en poursuivant : la maison Chastel est occupée par le docteur Payre-Ficot, sa femme, sa mère et trois enfants, un fils, deux filles ; la veuve Jullien, née Dethès, et sa cousine ; Adrien Constantin, menuisier et sa femme ; Hippolyte Philippe, marchand drapier et sa famille ; le boucher Frédéric Moutin, sa femme, un fils, trois filles ; Louis Moullet boulanger, sa femme, un fils, deux filles et sa nièce Marguerite Baretty ; Mélanie Astaud, née Bordel ; François Pau, cafetier, sa femme, sa fille, son gendre Abran maître-maçon et une pensionnaire Pauline Ammirati ; Martial Amon coiffeur et son beau fils Paul Roux ; Félix Girard, cultivateur et sa femme ; Fidèle Richaud cultivateur, sa femme Louise et son beau frère Joseph Bonnefoy tailleur d’habits ; Eugène Dethès cultivateur ; Adèle Pascal sans profession ; Eugène Aumage, sans profession, sa femme et leur petite fille Denise ; Henri Constantin cultivateur, sa femme, son fils ferblantier, sa fille ; Mélanie Reynaud cultivatrice, son fils, sa fille et une pensionnaire ; Paul Jarjayes épicier, sa femme, son fils Casimir cultivateur, sa fille Marie coututière ; Casimir Beauchamp cafetier, sa femme, son fils et son père Joseph ; la mairie ; Louis Dosithé Jean, employé de commerce de la maison Caïffa et sa femme ; Louis Mathieu Roubaud (83 ans) sans profession ; Paul Jullien cantonnier et sa femme ; Marie Garcin sans profession ; Marius Pascal sans profession et sa femme.
Puis, après la ruelle qui conduit à la Rosière : Vilhet Pauline couturière ; Signoret Joseph cultivateur ; Vilhet Amédée épicier pâtissier et sa femme (il avait eu la première bicyclette du village) ; Gaston Bonniol maréchal ferrant, sa femme, sa mère, sa sœur, un apprenti maréchal et deux enfants en nourrice ; Antoine Jullien voiturier et ses quatre enfants ; Gauthier Pierre Clair boulanger ; Casimir Aumage retraité ; la veuve Pinon née Bernard modiste ; Joseph Reynier cordonnier ; Philogène Bernard bourrelier, sa femme, deux enfants et son petit fils Rémy ; le village se termine de ce côté avec la cour de Philogène Bernard.
Franchissons la Grande Rue et dirigeons nous vers l’Eglise. On trouve en premier lieu, isolé du village, Jules Guérin cafetier, sa femme Thérèse et son neveu Bernard Germain ; dans un même grand immeuble allongé le long de la rue, Marcellin Sarlin sans profession et sa femme accoucheuse ; Jean Baptiste Gerbe agent voyer et sa famille ; Gauthier juge de paix, sa femme, sa fille ; Ferdinand Reynaud greffier de paix et sa fille puis, après la place, Joseph Marie facteur des postes, sa femme institutrice, leurs trois enfants, une pensionnaire Léa Gamet institutrice adjointe ; Pierre Pascal sans profession et sa femme ; Marius Dauteret journalier agricole, deux fils, une fille ; Denis Jullien menuisier ; Hector Abel Roussin, receveur buraliste, sa femme, son fils ; Auguste Guilliny, patron maçon, sa femme limonadière, son fils Auguste maçon, son second fils Maurice et trois filles ; Clémence Reynier ; Pierre Felix Gauthier, tailleur d’habits, sa femme couturière, deux ouvrières couturières et une pupille des hospices ; Eugène Constantin, sans profession ; Francis Daniel Arvieu, cordonnier, sa femme limonadière, deux fils ; Louis Reynaud négociant en chaussures sa femme et trois enfants ; Constant Louvrier receveur des postes et sa femme née Tindille ; Lambert Marie mercière et sa fille Laure.
On franchit ensuite la Basse Rue et l’on trouve Paul Bernard, notaire, et sa femme (il vient d’être nommé notaire de Séderon) ; Lucien Monard épicier et sa famille ; Charles Constantin retraité, sa fille Thérèse couturière ; Emilie Rousset, sans profession ; Gustave Coste patron cordonnier, sa femme, sa fille, son petit fils ; Arnoux Brie, cordonnier et sa femme ; la veuve Bernard et sa fille journalière ; Girard Amael patron boucher, sa femme Agnès et trois enfants ; Virginie Jarjayes 88 ans (c’est la doyenne du village) et sa fille Mélanie ; Albert Pascal huissier, sa femme épicière, leur famille et une fille pensionnaire Augusta Jullien ; Gianoglio Dominique maçon né à San Martino en Italie ; Gabriel Gilly cafetier, sa femme une domestique ; André Pontinacca, tailleur de pierre né à Pignerol ; Paul Jullien, sa fille Louise, son petit fils Louis Nicolas cultivateur et un berger ; Girard Jacques aubergiste, sa femme, sa fille Julie, veuve Bonniol, cuisinière : sont recensés à son auberge cinq pensionnaires dont un cordonnier italien qui travaille chez Louis Reynaud, un journalier, un cocher Joseph Bonfils ; Gilly Casimir scieur de long, sa femme, ses deux fils ; Jacques Andreis, marchand drapier né à Marmora en Italie, sa femme, ses deux filles, son frère Andrea marchand colporteur, son oncle Baptiste Gazini ; un jeune patron coiffeur qui vient de s’installer, Emmanuel Pellat, et a évité de justesse un sérieux accident le 4 juin « dans l’après-midi un client se faisait couper les cheveux chez M. Pellat notre nouveau coiffeur ; pendant l’opération le plancher a cédé entraînant M. Pellat avec son instrument à la main ». Fort heureusement il n’avait en mains que les ciseaux « si l’opérateur avait eu à ce moment là un rasoir on ne peut savoir ce qui serait arrivé à l’un comme à l’autre » ; Honoré Curnier cultivateur et sa femme ; la veuve Plaindoux, née Mélanie Monard, limonadière et une pensionnaire Joséphine Maccari ; on franchit la place et l’on trouve Martial Bonnefoy bourrelier, sa femme limonadière, sa fille, et Marcel Amier « pensionnaire bourrelier » ; la Grande Rue s’achève avec Augustin Roman, de Marseille, maître d’hôtel, sa femme Rose, son fils, un domestique Pellegrin, et trois pensionnaires : un cordonnier ouvrier chez Reynaud, un journalier agricole Fortuné Marie et un cocher de Barret-le-Bas, Michel.
Deuxieme groupe d’immeubles et d’habitants du village : la place et la Basse Rue.
Dans la Place, cinq maisons :
Casimir Imbert, patron maçon, sa femme Eugénie, sa mère Rose et trois enfants ; le charron Gontard, sa femme Constance, deux fils, une fille ; la gendarmerie avec le chef Michon et quatre gendarmes : Bompard dont la femme est couturière, Robin qui a deux filles et trois garçons, Girard, enfin Pelloux qui arrive à la brigade en septembre 1910 ; Marius Ollivier, maréchal ferrant, sa femme, deux fils Felix et Auguste, portés tous deux avec la profession de maréchal ferrant ; Scipion Espieu, patron boulanger, sa femme et six enfants, quatre fils, deux filles et un ouvrier agricole Isaïe Espieu.
En remontant la Basse Rue :
Rémy Bontoux facteur des postes, sa femme, son fils Rémy auxiliaire des postes, sa fille Victoria couturière ; Signoret Eugène cultivateur, sa femme Henriette née Dethès ; Jean Joseph un homme de 73 ans ; Jullien Jean Joseph cultivateur et sa famille ; Casimir Pascal, entrepositaire de bière, son fils Adrien apprenti boucher et quatre filles ; Séraphin Jarjayes postier avec sa femme et sa belle mère ; Eugène Doze cultivateur ; la veuve Revest née Pellat ; Désiré Jouve cordonnier chez Reynaud, et sa famille ; Marie Jarjayes et sa fille ; Joseph Lombard sans profession et son fils Paul ouvrier maçon ; enfin Aimé Jullien cultivateur et sa famille.
Troisième artère du village : la Rosière.
On y trouve du sud au nord : Joseph Dumont, cultivateur ; Clorinde Gabert, née Bordel, sans profession ; Louis Bonnefoy, sans profession ; Clodion Monge, facteur des postes, sa femme Marie née Constantin couturière, sa belle mère ; Marie Bonnefoy sans profession ; Gustave Jean cultivateur et sa famille ; Auguste Gauthier cultivateur, ses trois fils cultivateurs et son beau frère Joseph Moriés ouvrier agricole ; Paul Lombard cultivateur ; Désiré Signoret cultivateur ; Baptiste Bernard menuisier, sa femme, son fils Sully menuisier.
Nous franchissons le pont et terminons la nomenclature du village avec la Bourgade :
En partant du pont, et en remontant la rivière, on trouve Edmond Jouard, percepteur et sa femme qui occupent un immeuble appartenant à Lucien Bertrand ; David Bonnefoy, cafetier, sa femme, son fils Marcel et son père Auguste ; dans le même immeuble Louis Gabert brigadier de gendarmerie en retraite et sa femme Elisa née Beauchamp ; Nicaudi Madeleine née Chanuel, sans profession ; Paul Beauchamp cultivateur et ses enfants ; Adolphe Touche cultivateur, sa femme et ses cinq enfants ; Henri Curnier sans profession ; Paul Constantin brigadier des eaux et forêts, sa femme et son fils Jean. En traversant la rue, au presbytère, propriété de la commune, vivait Louis Istier curé et sa domestique Pauline Beauliet. En franchissant à nouveau la rue, Paul Bruis, patron forgeron, Régis Arnaud ouvrier agricole et sa mère Rose ; Isidore Conil maçon et sa sœur Rosine ; Paul Dethès cultivateur et son fils Victorin ; Paul Chauvet sans profession et sa famille dont son fils Frédéric horloger et photographe ; les quatre frères Coppo, italiens, étameurs ; Marie Gleize et ses quatre enfants, trois filles, Blanche, Claire, Eugénie et un fils Paul ; Faux, receveur d’enregistrement et sa famille. Au-delà du chemin vicinal vivaient à droite Justin Cotton, cultivateur, sa femme et ses deux fils, André et Louis (notre doyen) puis dans une maison isolée (l’ancienne école libre) Adélaïde Albouy institutrice libre avec sa nièce Georgette. A gauche on trouvait Henri Conil, cantonnier communal ; Mathieu Bernard cultivateur ; Médéric Espieu ; Eugène Gilly chef cantonnier et sa famille ; Madeleine Dethès ménagère, Alexandre Dethès journalier agricole, sa famille et Lea Villanova pupille des hospices de Marseille.
Enfin dans l’intérieur de la bourgade vivaient Paul Amic, garde champêtre, Isidore Clier journalier agricole, le charron Henri Roux, Rose Jullien, enfin Casimir Morin, cultivateur, avec sa femme Rosa, ses deux filles dont l’aînée Gabrielle est notre doyenne, son père Casimir et une pupille des hospices d’Avignon Joséphine Sarnette.
Nous en avons terminé avec le village. Suivons maintenant le facteur dans les écarts où vivent 157 habitants dans 39 maisons et 40 ménages, presque tous cultivateurs.
Au nord de l’Essaillon,
- dans le quartier des Manents, André Henri Jullien, sa femme, ses deux fils Paul et Camille et Louise Michel pupille des hospices de Marseille.
- Au Rieu Marius Pascal ; Ephrein Gay, sa femme, sa fille Eva, son beau père Louis Pascal, un pensionnaire Henri Roman, menuisier ; enfin non loin de la rivière et de la route qui conduit au Buis : Fabien Marcel, meunier, son frère ouvrier agricole et son frère nourrissier Christophe Feraud ; Eugène Lyon facteur des postes en retraite, sa femme, son fils Eugène Fortuné cultivateur ; Fortuné Pascal, cultivateur et sa femme ; Louis Pellat cultivateur et sa femme Marie ; Jean Monteil patron meunier, sa femme, un fils, deux filles.
Au sud de l’Essaillon et du village les écarts sont plus nombreux. On peut les classer en trois groupes :
Premier groupe, le long de la route qui conduit à Montbrun :
- au quartier de Rivaine Louis Meffre cultivateur, sa femme, et deux fils ; Hilarion Aubert et sa femme ;
- au quartier du Plan Gustave Girard cultivateur, sa femme, deux filles, Marie et Nancy, un fils Sylvain, et son beau frère Marc Gazador ; Louis Gilly cultivateur, sa femme et sa fille ;
- au quartier de la Tuilière Joseph Pascal cultivateur, sa femme leur fils Henri ; Joseph Bruis cultivateur, sa femme et cinq enfants ; Louis Bonnefoy, sa femme, sa fille Elodie, et Jean-Baptiste Tuillot leur berger.
Deuxième groupe d’écarts : ceux qui sont situés à gauche de la route qui conduit à Montbrun. Sept quartiers :
- Fressinières : Isidore Aumage cultivateur et sa femme ; Paul Dethès cultivateur, sa femme, sa fille, son fils et un domestique Marius Michel ; Dethès Marie et son fils Lucien cultivateur ; Chauvet Delphine sans profession ; Dethès Isidore rentier ; Fortuné Berthet cultivateur, sa femme, deux fils, deux filles et son oncle Casimir Pascal.
- Fontcolombe : Joseph Bonnefoy, cultivateur, sa femme, son fils, sa fille et Alice Champsaur bergère ; Arnoux Signoret ; Louis Noël Dethès cultivateur, sa femme, ses deux fils, sa pupille Marie Menassier, un berger Jean Mondon ; Paul Girard, sa femme, ses deux fils Aimé et Fernand, sa mère Marie, le berger Benoît Chabel.
- Lamourier : Gustave Ludger, sa femme, son fils, sa fille, Sarlin Cyprien berger ; Casimir Pascal et sa femme Léonie.
- La Barrière : Eugène Lambert, sa fille, son beau fils Alphonse Payan, Joseph Arnoux berger.
- Gondrin : Elie Bouillet, sa mère et Migliarini berger.
- Les Iscles : Daniel Dethès, sa femme Irma et Antoine Chauvet domestique ; Auguste Pascal cantonnier ; Eugène Arnaud cultivateur.
- La Gourre : Louis Roubaud journalier agricole ; Aimé Chauvet, sa femme et ses trois fils ; Maurice Richaud, sa femme, son fils, sa fille, son beau père, sa belle sœur ; Eugène Dethès, sa femme, sa fille Célina et son fils Henri.
Troisième groupe d’écarts : à l’ouest, c’est à dire à droite de la route de Montbrun :
- au quartier de Lioron : Victor Gilly et sa femme ; Joseph Chauvet sa femme, son fils ; Louis Chauvet, sa femme, ses deux filles ; Hippolyte Signoret, sa femme, leur quatre fils, leur fille, et sa mère Philomène ; Hippolyte Conil, sa femme, son fils Gabriel, Molinaro leur domestique, Fortuné Pascal leur berger.
C’en est fini du recensement.
Pour terminer l’étude de la population voici les noms qui figurent en 1910 aux registres de l’état civil :
- 10 naissances : Pierre Girard ; Louis Auguste Gilbert Bonnefoy ; Abel Emile Richaud ; Joséphine Hélène Touche ; René Emile Delhomme ; Fernande Julie Roux ; Jean Victorin Paul Constantin ; Louise Marie Séraphine Jarjayes ; Eva Louise Gay ; Suzanne Marie Henriette Payre-Ficot.
- 10 décés dont 4 enfants en bas âge (forte mortalité infantile) Madeleine Gauthier, veuve de Jullien Severin ; Antoine Joseph Bouillet ; Louis Emile Bruis 22 mois ; Francis Revest cordonnier "travailleur infatigable adoré des petits enfants du village" ; Louis Auguste Gilbert Bonnefoy, un mois ; Edouard Simon Gilly, du quartier Rivaine ; Edmée Laurence Selves, 2 ans 1/2, fille du notaire qui va bientôt quitter Séderon et cède sa charge à Paul Bernard ; Junith Curnier 69 ans, épouse de Louis Bonnefoy ; une pupille des hospices de 9 mois ; Marie Saïsse, décédée chez son gendre David Bonnefoy cafetier à la Bourgade.
- 7 mariages : Léopold Bonnefoy et Elodie Pascal ; Charles Tindille beau frère du receveur des postes et Rose Coste ; Richaud Fidèle et Louise Bonnefoy ; Léon Gauthier et Rose Favier ; Eugène Paul Blanc et Berthe Léa Gilly ; Paul Cannas et Marie Rose Bonnal ; Séraphin Jarjayes et Melle Pascal. J’y ajouterai en janvier 1911 les deux mariages d’Arthur Moullet cordonnier chez Reynaud avec Marie Mollard et Léon Pelloux gendarme avec Augusta Gontard.
LA VIE QUOTIDIENNE
Si les noms de la population n’ont pas tellement changé, il n’en est pas de même de la vie. Les 76 ans qui nous séparent de cette époque ont vu plus de transformations que plusieurs siècles antérieurs.
L’électricité, le gaz, l’eau sur l’évier sont inconnus. On se chauffe au bois ; on s’éclaire à la bougie, à la lampe à pétrole, à la lampe Pigeon. L’approvisionnement en eau est assuré par une pompe à la sortie Sud de la Grande Rue et une petite fontaine sur la place.
L’automobile est pratiquement inconnue : la première a fait son apparition dans le village vers 1902 ; ce fut un évènement ; l’instituteur interrompit sa classe pour la faire voir aux enfants. Les transports en 1910 se font encore par diligence. Les maisons sont modestes, sans confort, avec un mobilier rudimentaire ; les vêtements sont simples, indéfiniment rapiécés. On ignore les notions les plus élémentaires d’hygiène. Les rues, et même la Grande, sont encombrées de détritus et de fumier, par suite de l’importance du bétail vivant dans les écuries du village. Les chaleurs de l’été s’accompagnent, la sécheresse aidant, d’odeurs nauséabondes.
Un guide touristique de 1911 « la France inconnue » après avoir décrit la beauté des paysages (mais la difficulté des routes avec leurs lacets, leurs caniveaux et leurs « dos d’âne » ajoute sur Séderon : « Ce chef-lieu de canton d’une importance secondaire, ne mérite en aucune façon de retenir le voyageur ; la tristesse et la saleté de ses ruelles nous déterminent plutôt à repartir de suite par la vallée de la Méouge dont nous allons suivre les méandres capricieux jusqu’à sa jonction avec le Buëch. »
Mais derrière cette apparence peu séduisante ce village est vivant, bruyant, animé dès l’aube par les nombreuses activités de la population. Celles-ci sont de trois sortes : agricole, administrative, artisanale et commerciale.
Les activités agricoles sont les plus nombreuses.
Quelques 65 familles sur les 146 que compte le village vivent de l’agriculture, soit comme propriétaires, la grande majorité, soit comme journaliers. La statistique agricole de 1910 permet de connaître cette agriculture qui reste de forme traditionnelle.
En tête s’inscrivent les cultures vivrières :
- les céréales occupent 157 hectares – environ les 2/3 des terres cultivées – la céréale de base étant le froment, avec un rendement moyen modeste de 12 quintaux à l’hectare ;
- les pommes de terre et légumes secs viennent ensuite avec 36 hectares, dont 31 en pommes de terre, 5 en légumes secs ;
- enfin les arbres fruitiers avec en 1910 une récolte de 15 quintaux de pommes et poires et 10 de prunes ; noix et amandes et petits légumes des jardins ne sont pas définis dans la statistique.
Après les cultures l’élevage grâce aux prés qui occupent 42 hectares : 28 en prés naturels, 14 en prairies artificielles, trèfle, luzerne, sainfoin. Il s’y ajoute 1 hectare de betteraves fourragères. Comme bétail la statistique de 1910 annonce 8 vaches, 790 brebis, 180 chèvres, 220 porcs et, pour les transports et le labourage, 25 chevaux, 43 mulets, 6 ânes.
En 1910 une exploitation récente et rémunératrice s’était développée depuis quelques années dans le pays, la cueillette de la lavande qui avait entraîné l’établissement de 5 distilleries, annexes de fermes. Le journal le Montagnard écrivait le 13 août : « Nos coteaux sont maintenant sillonnés par de nombreuses personnes. Un voyageur du Nord qui verrait ces personnes le corps penché comme des moissonneuses allant alertes par ces coteaux avec une espèce de sac qu’elles remplissent avec promptitude se demanderaient ce qu’elles peuvent cueillir… c’est la lavande » et le journal ajoutait « on a vu l’essence atteindre le prix de 35 F le kilo ; ce prix est un peu élevé mais la moyenne est de 20 F… c’est un bon appoint pour quantité de ménages ; on comprend l’empressement à courir à cette cueillette, travail facile, à la portée de ceux qui ont le pied agile et la main alerte ».
Outre l’énumération des surfaces en culture, la statistique de 1910 donne des appréciations sur les résultats agricoles de l’année : année moyenne pour blé et fourrages, très mauvaise pour les pommes de terre, très bonne pour la lavande ; assez bonne pour pommes et poires. On avait craint pour les fruits la forte gelée tardive du 10 mai mais quelques arbres fruitiers en retard assurent une récolte moyenne. Les poires campanettes levées pour le midi et destinées à la confiserie se paieront 8 à 10 F les 100 kg.
Les deux autres activités du pays, artisanale et commerciale d’un côté, administrative de l’autre, étaient dûes à une excellente situation géographique à un carrefour de routes qui faisait de Séderon le centre d’une dizaine de villages.
Sur le plan administratif Séderon, chef-lieu de canton depuis 1800,
abritait quelques 25 familles de fonctionnaires : ce sont les mêmes que de nos jours, gendarmes, enseignants, postiers, agents des Ponts et Chaussées, percepteur, avec en plus une justice de paix et ses annexes, greffier, huissier ; un receveur d’enregistrement, une brigade des Eaux et Forêts. Il s’y ajoutent quelques professions libérales : notaire, médecin, accoucheuse.
Quand aux activités artisanales et commerciales,
elles faisaient vivre une soixantaine de familles, presque autant que l’agriculture. Elles étaient d’une grande variété, mais deux dominaient : chez les hommes les cordonniers, une dizaine, les uns patrons, les autres employés chez Louis Reynaud, fabricant et négociant en chaussures ; chez les femmes les couturières étaient une dizaine également ; leur travail apportait un petit appoint aux familles. L’éventail des autres professions était très ouvert :
- dans l’habillement : 3 tailleurs, 1 modiste, 1 mercière, 2 marchands drapiers,
- dans l’alimentation : 3 boulangers et deux meuniers, 4 épiciers, 3 bouchers, 1 entrepositaire de bière, 5 cafetiers et autant de limonadières,
- dans la construction : 7 maçons, 5 menuisiers, 1 ferblantier, 1 forgeron, 1 tailleur de pierres, un scieur de long,
- dans les transports : 3 maréchaux ferrants, 2 charrons, deux bourreliers, 1 voiturier et 2 cochers,
- dans les services et commerces divers : 2 coiffeurs, 1 horloger, 1 entrepositaire de journaux, des étameurs, 1 aubergiste, 1 maître d’hôtel.
Avec tous ces artisans c’était donc un village bruissant de vie qui s’éveillait tous les matins.
Vie municipale et élections
Cette petite communauté avait à sa tête, comme de nos jours un Conseil municipal élu alors pour 4 ans. Le Conseil municipal de 1910, élu en 1908 sera renouvelé en 1912. Il comprend 12 membres : docteur Payre-Ficot, Amédé Vilhet, Louis Reynaud, Sarlin Marcellin, Auguste Guilliny, Honoré Curnier, Etienne Coullet, Célestin Reymond, Auguste Gauthier et 2 élus qui ne figurent pas au recensement de 1911 mais sont propriétaires à Séderon : Lucien Bertrand, ancien notaire, ancien juge de paix, alors conseiller général du canton de Séderon, et député de l’arrondissement de Nyons, qui habite Lachau et l’herboriste Grivannes, depuis 16 ans conseiller municipal : « Très nombreux, écrit le Montagnard, sont les malades guéris par M. Grivannes qui ont eu la reconnaissance de publier leur guérison... il y a même des célébrités médicales qui recommandent les produits Grivannes ».
Les élections municipales de 1908 avaient sans doute donné lieu à une âpre compétition en cette période de lutte très vive entre l’Eglise et l’Etat au lendemain de la loi de séparation de 1905 et de l’inventaire des églises de 1906. Parmi les élus de 1908 dix appartenaient à la liste radicale menée par Lucien Bertrand et le Dr Payre-Ficot ; deux élus figuraient dans la liste réactionnaire : Louis Reynaud et Etienne Coullet.
Le conseil de 1908 réélit maire Lucien Bertrand, et nomme le Dr Payre-Ficot adjoint. Lucien Bertrand ne préside pas une seule séance du Conseil en 1908 et 1909. En 1910, une seule réunion du Conseil, le 19 juin, est mentionnée au procès verbal des délibérations.
En cette année 1910, quelques évènements notoires vont marquer la vie du pays. En premier lieu les travaux d’adduction d’eau. Il y avait jusqu’ici deux points d’eau seulement dans le village : une pompe à l’extrémité Sud devant le jardin de la maison Bernard, et une petite fontaine place de la gendarmerie. C’était nettement insuffisant et l’on se préoccupait depuis plusieurs années d’améliorer le service des eaux. Après des analyses faites à Lyon, on décide de capter l’eau d’une source du quartier de la Gourre, les Lesbrières. Les travaux commencent en 1909. On lit dans le Montagnard du 22 janvier 1910 : « C’est avec intérêt que notre population suit les travaux effectués pour l’adduction des nouvelles eaux dans l’agglomération de notre Bourg les travaux sont finis sur une longueur de plus de 2 kilomètres ; déjà on est au village ». Là, ajoute le journal, « les difficultés seront plus sérieuses ». Il fallait en particulier fixer l’emplacement et le nombre des fontaines et surtout celle d’un lavoir. « L’idée (d’un lavoir) est bonne, écrit le journal, presque urgente car la rivière, avec les immondices qu’elle reçoit, avec les crues qui surviennent, avec sa position exposée au froid rigoureux n’est pas précisément l’idéal » mais pour l’instant « nous ne savons pas quel sera l’endroit choisi ». Finalement on décidera l’installation de trois fontaines, aux deux emplacements antérieurs, plus une troisième fontaine à la Bourgade, et l’édification de deux lavoirs, un près de chaque fontaine, dont un grand placé sur le terrain dit de l’Hôpital.
Pendant 7 mois les rues furent un chantier permanent. On lit dans le Montagnard du 23 juillet : « Nos rues bouleversées par les ouvriers ont enfin été de nouveau livrées à la libre circulation ; c’est dire que le gros travail est presque fini ». Et le journal du 24 septembre note que le samedi 17 septembre la fontaine de la Bourgade « donne de l’eau limpide et abondante… enfin elle coule et toute la Bourgade est unanime à remercier tous ceux qui ont contribué à l’amener ; le remerciement est d’autant plus grand que la Bourgade est la première servie, juste compensation et réparation de l’oubli dont elle avait été l’objet jusqu’ici ».
A la fin de l’année, le 3 décembre 1910, le Montagnard constate que le mauvais temps, le gel, la pluie « ont empêché l’entrepreneur des fontaines d’achever la dernière, celle qu’on pourrait appeler la monumentale, et qui devait remplacer celle qui était près de la gendarmerie ». Aussi les ménagères du quartier doivent-elles aller s’approvisionner à la fontaine de la Bourgade « ce qui par ces temps n’est pas un amusement ». Les adductions seront achevées en 1911 avec les trois fontaines et les deux lavoirs. La réception des travaux et l’inauguration auront lieu dans de grandes fêtes en 1912 ; un buste de la République, don de Lucien Bertrand, sera installé sur la grande fontaine de la place de la gendarmerie.
Deuxième centre d’intérêt du pays en 1910 : la vie scolaire et les bâtiments d’école.
Garçons et filles sont séparés avec deux écoles distinctes. A la rentrée du 3 janvier 1910, l’école des filles abandonne le local qu’elle occupait depuis de nombreuses années à l’entrée Nord du village pour être transférée du côté opposé « à l’extrémité Sud sur la route de Montbrun dans un immeuble récemment acheté par notre sympathique conseiller municipal M. Guilliny et aménagé par lui ». Le nouveau local donna satisfaction aux usagers ; pourtant on aurait souhaité que « soit moins raide la pente du passage conduisant les enfants de l’école à la cour ».
Après les vacances d’été, à la rentrée le premier octobre, le Montagnard observait « mêmes locaux et mêmes maîtres… on est heureux de retrouver les éducateurs de l’année dernière occupant les mêmes places ». « Et pourtant, ajoute-t-il, un conseiller municipal a essayé de faire partir l’un d’eux en tentant de faire circuler une pétition ». Les parents « ont fait justice des allégations saugrenues qu’elle contenait en refusant de signer ». Quelques jours plus tard, le 19 octobre, se tenait à 10 heures la conférence pédagogique annuelle du canton avec pour thème « l’éducation générale et l’éducation professionnelle des élèves de l’école primaire élémentaire ».
Au début de décembre, à la suite de pluies torrentielles le Montagnard relate la « détérioration de l’école de garçons » ; le 1er décembre il y avait « plus d’un pan d’eau » dans l’école. Les élèves eurent deux jours de vacances forcées pour l’assèchement du local ; mais l’école restait provisoirement insalubre et « on a résolu de transporter la classe à la mairie ; mais là, nouveau déboire : le plancher n’est pas très solide ; un mur menace ruine ; beaucoup de parents ont hésité à y envoyer leurs enfants ».
L’état de l’école n’était pas seul à préoccuper la population ; il y avait aussi l’église. « La toiture est percée comme une écumoire ; il y pleut comme dans la rue ». Le curé Istier tente plusieurs démarches auprès de la municipalité puisque la commune est responsable de l’entretien du local. Ses interventions en février puis mai 1910 sont sans résultat. En novembre 1910 « une personne courageuse entraîne le chef de la municipalité dans cette église ». Malgré cette visite la situation ne s’améliore pas. Il faudra qu’en 1911 l’évêque de Valence retire le curé et déclare qu’il n’y aurait plus de prêtre dans la commune aussi longtemps que l’église resterait dans cet état, et les réparations seront faites.
Autre aspect de la vie dans notre village en 1910 : les manifestations de la vie collective, et en particulier les foires et les fêtes. Suivons-les au cours de l’année.
Elles commencent par les festivités de Noël et du Nouvel An. Le Montagnard écrit le 8 janvier 1910 que pour la Noël, après le repas du soir, on envahit les rues et les cafés. « L’animation la plus grande et la plus joyeuse n’a cessé de régner.
Vers les 11 h ½ les fidèles se rendent en grand nombre du côté de l’église » puis, après la messe vont réveillonner les uns chez eux en famille, les autres dans les restaurants et les cafés, mais à 3 heures – heure où doivent fermer les établissements publics – « la maréchaussée, exécutrice fidèle des règlements » est intervenue et a constaté un délit dans trois établissements.
En février, le dimanche 6 et le mardi 8 ont lieu, dans l’ancien bâtiment de l’école libre, deux grandes séances récréatives organisées sous la direction du curé Istier et données par les jeunes filles de la commune. La séance s’ouvre à 14 heures, devant 120 personnes, le maximum de ce que peut contenir la salle. La représentation est en deux parties.
- La première partie comprend plusieurs petites scénettes :
- L’enfant gâtée où se distinguent Rose Lambert et Marie Louise Prunier ;
- puis comme c’est le temps de Mardi Gras voici le Bonhomme qui arrive sur scène avec son bonnet et sa canne ;
- ensuite un chœur de servantes « nous a transporté sur un champ de foire ; chaque servante (rôles interprétés par Laurence Robin, Anne Martin et Marie Mollard) a fait valoir ses talents pour être louée plus cher ».
- Elles sont « adjugées à un maître par le juge de paix ; c’était un plaisir de voir ce juge (Léa Gilly) prendre son rôle au sérieux et tâcher de rétablir la paix sur le marché malgré les criailleries gouailleuses des servantes ; l’autorité du juge n’a pas pu arriver à obtenir cette paix et ramener le sérieux sur la foire ».
- « On riait encore de la déconvenue du juge quand on voit arriver un bossu qui, par la manière dont il a présenté ses deux bosses excite des fous rires ; il nous étale tous les avantages des bosses et finit par faire crier avec lui : Vive la bosse et les bossus ».
- On entend ensuite la chanson « les mouchoirs de Cholet » de Botrel interprétée par Laurence Robin et Laurence Pascal puis une comédie en un acte « Le mardi gras chez la mère Nathalie ». La mère Nathalie (Victoria Bontoux) est menacée d’être saisie par sa créancière, Mme Touchoulot (Gabrielle Maurin). Mais une duchesse, Rose Lambert, accompagnée de son marmiton (Laurence Pascal) vient à point la sortir d’affaire. La dette est acquittée et l’on peut célébrer le mardi gras avec joie ; puis c’est l’entracte :
- Deux jeunes enfants (Fernande Reynaud et Bernard Andréa) donnent, dans le Corbeau et le Renard, l’impression de bonnes actrices futures et, dans l’enfant terrible, Marie Louise Prunier laisse à l’assistance un souvenir impérissable.
- La 2ème partie de la représentation consiste en une opérette en 4 actes les deux servantes. Celles-ci, Anne et Jeannette, rôles tenus par Augusta Gontard et Marie Mollard, suscitent « un véritable enthousiasme ». La mère (Anna Moutin) est venue, avec Melle Aglaé (Rose Lambert) trancher avec le sérieux de la pièce et égayer la salle. Au total la séance dura 3 heures.
Le succès fut tel que cette matinée récréative fut à nouveau donnée le dimanche 6 et le mardi 8 mars avec quelques modifications en particulier l’addition des « Magnanarelles » qui, en cette période de renouveau provençal transportèrent l’assistance au pays de Mistral par la voix de Marie Mollard et Augusta Gontard. Pour annoncer le spectacle on avait choisi trois enfants, Georgette Albouy 7 ans, Madeleine Girard 5 ans, Anna Reynaud 2 ans ½. « De la manière dont elles se sont tiré d’affaire on peut dire que chez elles la valeur n’attend pas le nombre des années ».
En ce même mois de mars, le 16, se tenait le conseil de révision ; les 43 conscrits du canton ont défilé « dans la ville au son du tambour en chantonnant quelques refrains guerriers ».
Fin mars, le 28, la société de tir, récemment fondée donnait sa fête annuelle. Elle était présidée par Roussin, le receveur buraliste, ancien adjudant, assisté de l’instituteur Moncquet, trésorier et d’Ollivier fils secrétaire. De 8 heures à 3 heures de l’après-midi les tireurs se sont succédés, avec des prix offerts par des donateurs généreux ; la fanfare de Séderon, dirigée par Meffre et Marie, prêtait son concours ; des jeux organisés par le maréchal ferrant Gaston Bonniol ont égayé l’assistance ; le soir à 11 heures un superbe ballon est monté dans les airs aux applaudissements de tous ; le bal a battu son plein jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Quelques jours plus tard, le 4 avril, c’était jour de foire. Mais la neige tombait en abondance, la foire fut renvoyée au lendemain mais n’eut pas plus de succès car le mauvais temps persistait.
Le samedi 16 avril Monseigneur Chesnelong, évêque de Valence, venait à Séderon. Le dimanche 17 avait lieu la cérémonie de confirmation dans une église bondée. L’après-midi il présidait les manifestations du Congrès catholique. Après des chants et une allocution à l’église de l’archiprêtre Istier, le cortège se mit en marche, drapeau en tête, vers la salle de réunion de l’école libre où l’évêque prit la parole (ainsi que des représentants de divers groupe d’associations catholiques).
Le 3 juin, c’était à nouveau la foire, cette fois par un temps superbe. « De fondation assez récente elle commence à prendre, malgré son voisinage avec la foire de Lachau de Saint Barnabé. Les transactions ont été nombreuses », mais comme il y avait plus de vendeurs que d’acheteurs les cours étaient en baisse, en particulier sur l’espèce porcine.
Quelques jours plus tard, le 7 juin, le certificat d’études donnait une petite animation au chef-lieu du canton ; 22 candidats se présentaient ; à Séderon étaient admis Léon Touche et Julie Touche.
Le 26 juin, c’était le grand jour de la fête votive. Jusqu’ici elle avait eu lieu “le dimanche qui suivait le 20 mai ou le dimanche après Saint Baudile”, patron protecteur de la commune, mais le conseil municipal avait décidé de changer la date « à cause de la pluie qui arrivait trop souvent ce jour là ». Le Montagnard écrivait le 18 juin : « des affiches le feront savoir aux communes éloignées ; des salves d’artillerie le rappelleront aux communes plus rapprochées ; les attractions et les jeux seront aussi nombreux et variés qu’aux années précédentes. C’est la partie Nord qui cette année aura le plaisir de posséder les attractions qui amènent avec elles beaucoup d’avantages pour quelques uns, et quelques inconvénients pour d’autres. Enfin, heureusement pour ceux qui veulent dormir la nuit entière, la fête votive n’arrive qu’une fois par an ».
Le programme de la fête était des plus alléchants. Il prévoyait le 26 juin au matin un concours de tir ; l’après-midi à 3 heures des jeux divers, à 4 heures des courses de chevaux, mulets et ânes ; à 9 heures un feu d’artifice ; enfin ‘un grand bal desservi par un orchestre d’élite’. Les manifestations devaient se poursuivre le lundi 27 : à 10 heures concours de boules ; à 2 heures concert donné par la fanfare de Séderon ; à 4 heures jeux de la cruche, du baquet, de la poële ; et dans la soirée bal. Des stands devaient agrémenter la fête : « carrousels, montagnes russes, balançoires, attractions diverses ». Le 25 juin au soir, comme il était prévu au programme, la fête était annoncée par des salves d’artillerie, mais bientôt, écrit le Montagnard, « le tonnerre permit d’économiser la poudre ». Le lendemain, le temps fut humide, ‘maussade, le soleil absent’ et la fête fut partiellement ratée. « La fatalité, d’autres disent la nature, d’autres disent St Baudile, voulurent jouer un tour au Conseil Municipal ; Celui-ci avait changé le jour sous prétexte de pluie et voici que la pluie changeant de jour se réserve pour le 26 juin ». Le journal relatait le mécontentement des commerçants « qui font une perte sèche d’un millier de francs », il est vrai, ajoute le Montagnard, que « beaucoup d’agriculteurs ont accueilli cette pluie avec joie ».
Quelques trois semaines plus tard, le 14 juillet était célébré par les républicains : 7 ou 8 convives prennent un repas à l’hôtel et le soir, une trentaine de personnes sont présentes à l’apéritif.
Puis les festivités s’arrêtent en juillet-août avec les nécessités du travail des champs et des récoltes. Le 28 août le journal mentionne l’ouverture de la chasse. Lièvres et perdrix « n’auront pas beau jeu... ce qui chagrine un peu nos chasseurs, c’est le prix de la poudre qui a presque doublé cette année ». Au reste, la poudre n’est pas le seul produit dont on mentionne l’augmentation. Il y avait aussi, plus importante pour la vie des ménages, la hausse du pain, essentiel dans l’alimentation d’alors. « Pendant quelques temps, écrit le journal, nos braves boulangers ont résisté à la poussée de tout augmenter » mais ils ont dû céder et à partir du 1er novembre le pain passe de 30 à 35 centimes le kilo.
Avec l’automne la vie collective reprenait sous la forme des foires :
En 1910, celle du 21 septembre (la St Mathieu) favorisée par un temps exceptionnellement beau fut très fréquentée, avec des transactions actives, en particulier sur les bêtes à laine. En octobre la foire du 21, de création récente, était également favorisée par le beau temps et animée. Des quantités de bestiaux y étaient échangées. Par contre le journal mentionnait la difficulté que l’on avait eue à vendre les pommes et émettait un vœu : « Combien il serait à souhaiter que les propriétaires utilisassent leurs pommes qui ne se vendent presque rien et en fassent du cidre. Ce serait le moyen de remplacer le vin qui est trop cher ». Le surlendemain de la foire, le 23 octobre, la neige faisait son apparition au sommet du Taï et du Négron. Cela n’empêchait pas un certain nombre de pères de familles catholiques d’aller à Montbrun où se tenait une conférence de l’Association Départementale des pères de familles catholiques en vue de constituer une Association Cantonale.
Avec novembre et décembre c’est surtout le mauvais temps qui retient l’attention du journal : la pluie, le vent, la neige. Les rues, défoncées par les travaux d’adduction d’eau se transforment en bourbiers « bientôt, il faudra faire comme la jeunesse, s’armer d’échasses pour éviter la boue qui encombre nos rues ».
Puis arrive la Noël et c’est le retour des réjouissances de fin d’année.
Ainsi les occasions de réunions et de fêtes n’avaient pas manqué en 1910. Pourtant nous n’avons encore rien dit de ce qui avait été une des distractions de l’année, les élections.
C’est sur le plan politique une période tourmentée :
avec le ministère Combes (1902-1905) et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, les positions se sont durcies entre les catholiques d’un côté, l’Etat radical de l’autre et l’on est en France dans une période d’anticléricalisme ardent ; une section de la Libre Pensée s’est organisée à Séderon et encourage les enterrements civils.
Si le maire Lucien Bertrand n’est pas par lui-même un homme de combat, il soutient régulièrement par ses votes à la chambre la politique du gouvernement radical. Son adjoint, le Dr Payre-Ficot, en même temps conseiller d’arrondissement, n’est pas non plus un sectaire, mais il doit lui aussi en tant que radical adopter des attitudes de combat et on le voit intervenir et prendre la parole lors des enterrements civils.
Comme l’écrit le Montagnard, d’inspiration catholique, à votre dernière heure le "curé" Ficot « au risque de perdre un peu de graisse bravera les chaleurs les plus fortes » pour présider aux enfouissements et distribuera « les consolations que donne la Libre Pensée : ne vous attristez pas ; après la mort, tout est mort ; tachez d’oublier au plus vite ; ainsi soit-il ».
La population de Séderon, dans sa grande majorité ne partage pas cette ardeur anticléricale. Si la plupart des hommes ont cessé d’aller à la messe, ils tiennent à ce que leurs enfants soient baptisés et fassent leur première communion ; ils admettent que leurs femmes aillent à la messe, que l’on enterre religieusement leurs morts.
Aux dernières élections Municipales, celles de 1908, les électeurs – les hommes seuls ont droit de vote – s’étaient partagés presque également entre réactionnaires et radicaux, votant plus pour les hommes que pour ce qu’ils représentaient politiquement. Le radical Lucien Bertrand venait en tête des élus avec 127 voix ; le Dr Payre-Ficot en avait 123 mais le réactionnaire Louis Reynaud en avait 113.
En 1910 Séderon va connaître trois consultations électorales, une législative, deux cantonales et la fondation du journal le Montagnard en décembre 1909 est sans doute liée à l’élection législative de 1910.
Dans son numéro un le journal déclarait dans sa profession de foi qu’il applaudirait « aux améliorations qui pourront apporter l’aisance et le bien être », enregistrerait « les réclamations utiles et profitables », dénoncerait les abus et travaillerait « au développement et à l’application du progrès dans la région… Il n’y a que la politique qui chômera car le journal ne veut s’inféoder à aucun régime ; l’expérience a montré que c’est la politique qui divise et sépare et nous voudrions l’union, l’union de tous les montagnards ». Quand on parle autant d’union c’est en général qu’on veut la faire à son profit ; dans la pratique le Montagnard prendra nettement position dans les élections et ses articles politiques seront nombreux en 1910.
La première élection de 1910 fut l’élection législative du 24 avril.
Lucien Bertrand, député sortant, radical socialiste, avait été élu en 1902 contre le comte d’Aulan ; réélu facilement en 1906 il se représente en 1910. Les parlementaires sortants de 1910 avaient plutôt mauvaise presse car une de leur première mesures, après leur élection en 1906, avait été de voter une augmentation substantielle de l’indemnité parlementaire portée de 9 000 à 15 000 F.
Malgré cette impopularité des sortants Lucien Bertrand affichait une grande sérénité. Il déclarait dans une interview en mars : « Je suis bien tranquille sur le sort que réserveront mes électeurs à mon mandat de député ; n’ai-je pas ponctuellement rempli mon mandat ? Il serait difficile, je crois, de trouver un électeur ayant eu recours à mon intervention auquel j’aie refusé mon aide ». Le journal l’Avenir deNyons est du même avis « M. Bertrand a rendu beaucoup de services et assurément demeure bien fortement embusqué dans ses retranchements ». Malgré cette confiance du député sortant, la campagne s’annonçait animée car deux redoutables concurrents locaux surgissaient contre Bertrand : à gauche Emile Lisbonne, originaire de Nyons, substitut à Marseille, radical socialiste plus marqué que Bertrand ; à droite un républicain modéré, originaire de Ballons, Gebellin, qui avait comme Bertrand, la poignée de main facile et une forte position locale, dont la candidature est soutenue par un journal qui se fonde alors pour les besoins de la cause, "la Démocratie rurale".
Le lundi 4 avril à Séderon « a commencé l’ouverture des hostilités entre les divers candidats aux 15 000 F ». A 2 heures ½, Lisbonne tenait une réunion à la mairie ; le soir c’était Gebellin. Le lendemain 5 avril c’était au tour de Lucien Bertrand. Celui-ci n’était pas un orateur ; le Montagnard qui lui est peu favorable relate ainsi la séance : « le discours commence ; les lunettes tombent ; (on les remet) le discours continue ; les lunettes tombent encore et au cri de 15 000 F, elles tombent pour n’être plus remises sur le nez. Eh bien ! dit-il, si vous n’êtes pas content, renvoyez-moi avec des coups de trique, des coups de pieds au… ; son lieutenant M. Ficot, titre qu’il s’est donné lui-même au banquet de Montfroc, lui vient en aide » et au bout de 12 minutes la séance est levée.
Le 23 avril le journal écrit « les affiches encombrent nos murs » et ajoute qu’il vaut mieux en ce moment ne pas être malade car on s’exposerait à ne pas trouver le médecin « obligé qu’il est d’accompagner son chef hiérarchique – dans les visites du canton, il est nécessaire pour réconforter le candidat et peut-être réchauffer la candidature ».
Le journal catholique de Valence, la Croix de la Drôme, fait remarquer qu’en ce mois électoral d’avril les journaux électoraux de gauche publient de nombreuses lettres venant des ministères ou de la préfecture accordant des faveurs, ou en promettant, à la demande de Lucien Bertrand.
A Séderon au scrutin du 24 avril, Bertrand eut une très large majorité : 145 voix, Lisbonne en avait 18, Gebellin 14. Dans l’arrondissement la lutte fut serrée, mais Bertrand distançait Lisbonne qui se désista pour lui. Au second tour, le 8 mai, Bertrand eut à Séderon 152 voix, Gebellin 33 ; il fut élu député de l’arrondissement par 3 924 voix, contre 3 160 à Gebellin.
Le dimanche soir, lorsqu’on connut les résultats du scrutin, des partisans Séderonnais de Lucien Bertrand poussèrent l’enthousiasme jusqu’à chanter une partie de la nuit, puis à distribuer des coups de pied à certaines portes en poussant des cris et en s’accompagnant du tambour. Le 16 juillet le Montagnard faisait savoir à ses lecteurs que le nouveau député, qui était aussi l’ancien, avait touché sa première mensualité de parlementaire soit 1 185 F, qu’il avait laissé 50 F pour sa retraite, 10 F pour sa carte de circulation gratuite sur les réseaux de chemin de fer, 5 F pour ses frais de bureau, « 10 F pour aller voir ses électeurs, 5 F pour leur écrire ».
Cependant une nouvelle élection approchait :
le renouvellement du Conseiller Général en août. Lucien Bertrand, conseiller sortant, renonçait à son siège au profit du Dr Payre-Ficot. Le Montagnard écrit le 23 juillet : le Dr Payre-Ficot sait « parler à chacun en particulier. Si dans une commune assez dévouée à son chef de file M. Bertrand, il parle en termes élogieux du député, dans une autre, délaissée par le député, il ne craint pas de vanter son inertie et donner les raisons de son peu de dévouement à cette commune. En un mot amis et adversaires de Bertrand se rencontreront tous sur le nom de M. Ficot ».
Le docteur trouvait en face de lui plusieurs concurrents : Maigre, maire de Laborel, conseiller d’arrondissement ; Leydier de Montbrun ; Elie Meffre de Montauban. A Séderon il eut une majorité écrasante, ses concurrents totalisèrent 6 voix ; il fut élu facilement conseiller général. Payre-Ficot devenait le benjamin du Conseil Général de la Drôme. Il adresse aux électeurs du canton une circulaire de remerciements « Et maintenant au travail pour les intérêts économiques de nos chères communes… Je ne conserve de la lutte aucune rancune envers personne et je vous renouvelle l’assurance de mon entier dévouement à vos intérêts. Encore une fois merci. Vive le canton de Séderon ! Vive la république démocratique, laïque et sociale ». Lors de l’ouverture de la 1ère session du nouveau conseil général, le 19 septembre, le Montagnard écrivait « Tant pis s’il y a des malades ; les gens n’ont qu’à le savoir et prendre leurs précautions ».
Le docteur Payre-Ficot était un des deux conseillers d’arrondissement du canton, l’autre étant Théodore Maigre de Laborel. Il faudra une 3ème élection, le 18 septembre, pour le remplacer au Conseil d’arrondissement. Le Montagnard écrivait à ce propos « qu’il fait bon être citoyen français à Séderon car on a de nombreuses occasions de montrer que l’on fait partie du peuple souverain. Tout de même quelques citoyens préfèreraient aller moins souvent chez le percepteur pour payer des impôts qui augmentent, quitte à aller moins souvent voter pour des gens qui probablement se moqueront d’eux le lendemain ». Les candidats à cette fonction, au demeurant modeste, de conseiller d’arrondissement, furent nombreux : Auguste Bontoux de Montguers, Elie Meffre de Montauban, Grivannes, conseiller municipal de Séderon, Roman maître d’hôtel à Séderon, enfin Victor Brissac maire de Ballons. Au premier tour les voix se partagèrent de façon géographique, chaque commune votant pour son candidat. Brissac vint en tête, resta seul candidat au second tour et fut élu. Il remercia ses électeurs dans une circulaire que donne l’Avenir de Nyons : « Vous avez une fois de plus fait abstraction des personnes pour n’envisager qu’un seul but, l’intérêt de la République... La confiance que vous venez de me témoigner me fait un devoir de m’occuper des intérêts de notre cher canton. Croyez que j’y mettrai tout mon dévouement et ne faillirai pas à ma tâche. Vive le canton de Séderon ! Vive la République ! ».
Le 5 novembre, le Montagnard écrivait « Un de nos conseillers municipaux, ancien candidat au conseil d’arrondissement (Grivannes) a pris l’engagement d’instruire le peuple des dessous de la politique. Ceux qui l’ont entendu avouent qu’il en sait long ; d’ailleurs personne n’en doute puisqu’il a vécu avec les politiciens » et le journal ajoutait que dernièrement encore « il véhiculait un candidat au conseil général (Dr Payre-Ficot) qui depuis, paraît-il, l’a lâché comme il en a lâché d’autres ; il avait promis à tant la place de conseiller d’arrondissement que raisonnablement il ne pouvait contenter tout le monde » et le journal concluait qu’avec ces révélations « on va rire cet hiver ; ce sera l’épilogue de cette série d’élections où beaucoup ont été appelés et peu ont été élus ».
Ces plaisirs électoraux ne devaient pas s’arrêter là, car peu après, l’autre conseiller d’arrondissement, Théodore Maigre, décédait subitement et l’élection était fixée au 5 février 1911. C’est le pharmacien Barral de Montbrun, républicain de gauche, c’est-à-dire un modéré, qui fut élu contre Roman de Séderon, radical socialiste. Barral avait eu toutes les voix de Montbrun sauf trois ; il en avait eu 22 à Séderon.
Ainsi il y a 76 ans notre village est un petit centre local très vivant, aux activités variées, aux nombreuses manifestations collectives. Mais derrière cette animation, il ne faut pas se dissimuler que la vie quotidienne est difficile car les ressources sont faibles et les agriculteurs souvent victimes des intempéries et de la mévente. Or avec le progrès des communications, les contacts se sont multipliés avec l’extérieur. En particulier les jeunes hommes de la commune, à la faveur d’un service militaire rendu obligatoire et universel par la république, ont vu d’autre régions où les conditions d’existence sont plus faciles et sont tentés par le départ. Les uns restent à l’armée, rengagent puis entrent dans la gendarmerie, les douanes, les Eaux et Forêts. D’autres cherchent à obtenir des places, dans les Postes, aux Ponts, et pour les obtenir sollicitent l’appui du député ; c’était un des "services" que Lucien Bertrand rendait à ses électeurs.
En 1910 le Montagnard écrit qu’à Séderon « il ne se passe pas un mois sans qu’un nouveau départ soit signalé ». L’hémorragie n’est pas encore grave en 1910, mais elle est déjà sensible puisque la population depuis 30 ans a fléchi de 700 à 616 habitants. Elle devait s’accélérer avec la guerre de 1914 qui a saigné à blanc nos villages (20 morts de jeunes hommes à Séderon). Depuis, les progrès de l’automobile qui permettent de s’approvisionner facilement dans les villes voisines ont condamné à mort la plupart de nos artisans alors que ceux de la mécanisation condamnaient la plupart des agriculteurs. Dans ces conditions nouvelles de l’économie, la période de l’entre deux guerres, puis les décades qui suivent la seconde guerre mondiale ont vu fondre la population de notre village.
Mais ceux qui partaient lui sont restés fidèles. Ils y revenaient pour les vacances, puis, du moins une partie de l’année, à leur retraite. Ainsi se préparait la mutation qui donne à notre village sa physionomie actuelle : un village qui se peuple et s’anime pendant l’été, avec un habitat très amélioré de coquettes résidences secondaires.
Documentation :
Archives communales de Séderon
- Etat civil de 1910
- Statistique agricole de 1910
- Recensement de mars 1911
Ponts et Chaussées de Séderon
- Plan des alignements de la Bourgade et de la Grande Rue de 1908.
Archives départementales de la Drôme
- Journaux :
- Le Montagnard de Séderon et des Baronnies dont le premier numéro paraît en décembre 1909.
- l’Avenir de Nyons
- la Croix de la Drôme
Renseignements oraux donnés par les habitants de 1910, en particulier par le doyen du village, M. Louis Cotton, alors dans sa soixante-dix-septième année.